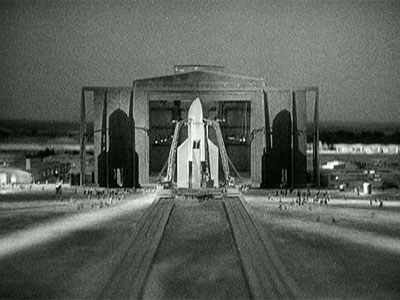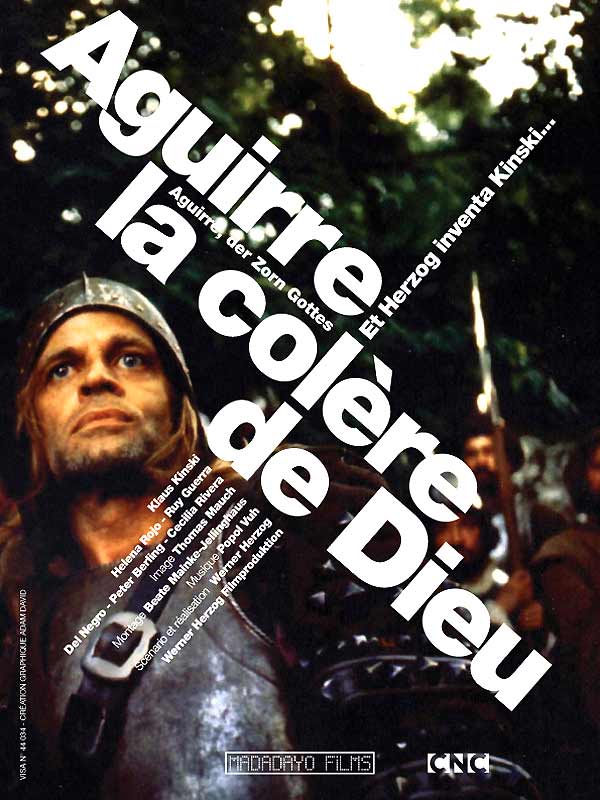Très bon film, avec un casting impecable et en particulier le personnage du Docteur Gogol interprété par un Peter Lorre qui passe de la compassion à la manipulation puis à la folie et à la cruauté avec une crédibilité sans faille. Un bon rôle. A la réflexion, je me demande si ce n'est pas suite à ce film que "gogol" pour signifier "fou" est entré dans notre langage commun, car Gogol est bien le nom choisi dans la version américaine et servait à indiquer les origines "exotiques" du Docteur (probablement une référence à l'écrivain).
Ajouté à cela les décors qui tiennent lieu de l'expressionnisme allemand même si l'action est censée se dérouler à ... Paris et que le film est tourné aux USA. Il y a des emprunts à Murnau et Fritz Lang dans ce film, c'est patent ; ne serait-ce que par le choix de Peter Lorre. Esthétisme d'une époque, sans aucun doute.
Il y a en particulier un traitement astucieux des décors de la clinique du Docteur qui alternent les parties professionnelles, organisées, rationnelles, méthodiques, rassurantes et les parties privatives baroques, tordues, alternant les zones d'ombres et de lumières fortement contrastées, des escaliers qui semblent comme déformés. Cette clinique en devient comme une expression manifeste de la schizophrénie du Docteur. On retrouve ce même traitement dans le choix du personnel de la clinique très organisé et professionnel et de la gouvernante du Docteur Gogol qui est .. ailleurs !
L'histoire est connue, celle d'un pianiste victime d'un accident qui le prive de ses deux mains. Un seul chirurgien peut le sauver en tentant une greffe avec les mains d'un meurtrier guillotiné de frais (euh, non, on dit rasé de frais et guillotiné de peu). Les pulsions meutrières de ces mains vont-elles se transmettre ? Le Docteur Gogol étant amoureux de la femme du pianiste et passablement déséquilibré mental, comment les deux parcours vont-ils s'imbriquer ? Vous le saurez en regardant ce très bon film de 1935
Ce film - est-ce le premier du genre ? - a engendré une vaste lignée sur le même thème, jusqu'au récent "La Piel que habito".